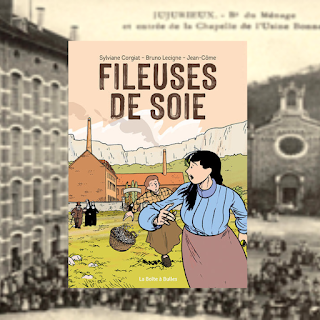💙💙💙💙💙
A partir d’un drame bien réel, celui du "Malabar Princess" de la compagnie Air India en 1950, qui s'est écrasé sur le Mont-Blanc en faisant 48 morts. L’avion aurait contenu des lingots d’or...
L’histoire :
Dans un hameau de montagne, deux frères que tout oppose.
Isaïe, l’ainé est gentil, sincère. Un amoureux de la montagne, des animaux, de la vie simple qu’il mène avec ses brebis.
Marcellin est vénal, égoïste et ne souhaite que regagner la ville, où il pourrait tenir un commerce à condition de vendre leur maison…
Isaïe a quasiment élevé Marcellin à la mort de leurs parents et l’aime profondément. C’est son petit frère mais c’est aussi son fils...
On comprend vite aussi qu’Isaïe, un ancien guide, se débat contre de mauvais souvenirs, un accident d’alpinisme, qui lui a laissé quelques séquelles…
Marcellin va se livrer à un chantage pour persuader Isaïe d’entreprendre l’ascension, rejoindre l’avion et trouver ses trésors.
Isaïe n’est jamais remonté depuis son accident, il a peur mais cède à son frère.
Les conditions sont épouvantables, c’est éprouvant, intense, la montagne ne fait pas de cadeaux.
Pourtant au fur et à mesure qu’ils montent, Isaïe retrouve son expérience, sa solidité, son esprit solide.
Même Marcellin le remarque : « Qu’est-ce qui t’arrive, Isaïe ? Je ne te reconnais plus depuis le début de l’ascension.
C’est comme si le souffle de l’air pur avait lavé l’intérieur de ta tête. »
Sauf, qu’arrivés près de l’avion, rien ne va se dérouler comme prévu.
Les happy end, ce n’est pas le genre d’Henri Troyat…
Sublime graphisme : classique, très travaillé sur les visages, les expressions, les couleurs et les paysages. Chaque planche est un petit bijou.
Le dessin apporte une densité supplémentaire au récit d’Henri Troyat qui était déjà bien prenant.
Un huit clos tragique en pleine nature dont la conclusion sera à l’image de la montagne : sauvage, puissante, glaciale et terrible.
Merci à Lecteurs.com et aux éditions Rue de Sèvres pour cette découverte passionnante.


.png)